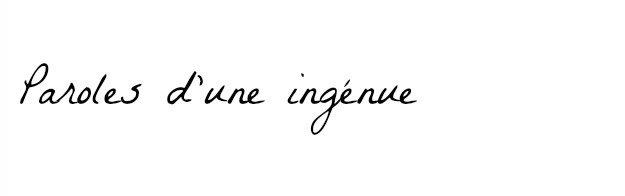Il était intense,
comme un coucher de soleil après une tempête au printemps. Ses yeux à eux seuls
suffisaient à réveiller la brûlure du désir, de la douleur. C'étaient les vaisseaux d'un drame
sentimental en devenir. Deux globes bleu azur, limpides, brisés seulement par quelques
éclats pourpre, et qui semblaient détenir l’entièreté du monde sous un voile de
cils de jais. Sa bouche était celle d’un chérubin, tracée par le pinceau d’un
artiste, rougie par la sensualité; faite pour mordre, pour susurrer, et pour
aimer. C'était un être autour duquel on ne pouvait s’empêcher de s’abaisser à un
certain instinct animal, celui de la méfiance, par peur d’un jour le voir
arraché à soi. Tout perdre.
Son pas, gracieux et félin, était la preuve de sa gourmandise, son refus à la monogamie. Et ses pupilles écumaient rapidement les rues, les terrasses des cafés, les pistes des boîtes de nuit à la recherche d'une Autre: une entité plus vivante, au
parfum sucré, qui lui donnerait la réalité du rêve, et non pas juste
l’illusion. Car il n’était pas un homme entier, mais l’assemblage d’une
multitude de voyages, d’expériences, et de souvenirs cousus ensemble par un fil
de passion, empreinte éternelle des femmes avec qui il avait été précédemment, qui languissaient sous sa peau pour faire battre son coeur. Il ne supportait
pas l’ennui, ni la monotonie de la vie, la vraie, et acceptait uniquement des
visiteurs éphémères dans la sienne pour combler le gris sale d’une existence
banale. Des individus de passage, tristes divertissements aux visages flous,
dont l’occupation se limitait à son amusement, à voiler la vérité du monde, et
à flouter celle-ci dans un jeu de miroirs. Si il avait été un livre, c'est Sagan qui l’aurait écrit.
Moi, je ne
voulais pas faire partie de ces poussières temporelles. J’aurais voulu être la
Muse, la Seule, sa drogue indispensable; celle dont le manque ne pouvait que mener à la fatalité. J’aurais voulu me démarquer, être dotée du don inné qu’est cet hypnotisme, ce certain je ne sais quoi que revêt la femme irrésistible, qui fait du prédateur
la véritable proie.
Mais c’était lui
le véritable maître de cette valse des corps et de l’esprit. Au bout de ce qui
aurait pu être un souffle, une poignée de secondes, son toucher m’était déjà devenu
enivrant et nécessaire, comme un verre de vin autrefois, avant
notre rencontre… quand il n’était pas encore étoile et moi orbite. L’étreinte
serrée de ses bras, la caresse dure de son regard m’étaient devenus seuls
plaisirs, remèdes uniques à mon manque d’amour propre, caractéristique
culte à la génération mélomane et mélodramatique des millénaires. Je me
remémore ses doigts ondulant autour de mes seins, puis les frissons qui en résultaient simultanément, florissant au contact de sa peau.
Et son être en moi, délicieux moment de chute, où le mental s’abandonne enfin
au physique; quand l’éternité semble palpable, après tout. L’entremêlement de
la force et de la vulnérabilité, les deux moteurs contraires du monde, qui
délaissent leur véhémence mutuelle le temps d’un instant, en s’enlaçant, pour
faire éclore cet elixir universel, cette synesthésie ultime qu’est l’orgasme.
Au fond,
l’addiction reste inchangée: seul le navire qui l’aborde sur les rives de la santé
émotionnelle s’orne d’un nouveau visage. Et nul ne vous prévient à l’école des
dangers de l’amour. On s’empresse d’informer la jeunesse, fruit d’innocence, du nombre de morts causés par l’alcool et l’héroïne, mais on s’abstient de
donner les statistiques vertigineuses de ceux et celles qui ont péri par coeur
brisé, cette maladie virale, cancer redoutable de l’humanité ancienne, moderne et
post-moderne sûrement, dont le remède unique est l’annihilation des
dernières particules de force ayant la chance d'y avoir survécu.
Si la destruction
mène inéluctablement à la création, alors me voilà artiste à la carrière illustre. Depuis ce début de la fin, la totalité de mes
atomes s’unissent chaque seconde pour former un cri de lamentation interne - triste chorale chétive. Ils se multiplient dans cette vibration des voix pour
ensuite se déchirer, comme le tissu de mes organes, devenus engins moisis dans un corps vidé. Mon corps. Autrefois havre de bonheur, éclairé par la lueur de mon
espoir amoureux, il demeure aujourd’hui comme espace creux, sombre et lugubre,
aux airs d'hôtel en bord d'autoroute.
Pour toi, c’était
court, agréable, léger—comme le premier café-clope du matin. Un moment parmi tant
d’autre, une parenthèse à collecter, à rajouter à l’amas de petits bouts de
tissus émotionnels qui te composent, et font de toi un semblant d’être, une illusion parfaite.
Mais moi, je ne
suis plus qu’un produit défectueux, dénué de ce qui faisait de moi une femme,
une vraie de vraie, non pas une poupée factice comme celles dont tu aimes
t’entourer maintenant que tu cherches l’amour dans l’esthétisme; que tu aspires aux romans à
l’eau de rose. Je te déçois, je sais : je ne suis pas faite de poudre d’astres,
ni d’étincelles. Je suis faite de sang, d’eau tiède, d’urine et de transpiration.
Je suis réelle ; mais pour toi, cela se traduit par la conséquence désastreuse
d’un monde imparfait. Et pourtant, quand j’existais, j’étais satisfaite par cette vérité
pure. J'aimais qui j'étais. J'étais fière de mes cicatrices.
Mais maintenant,
je n’en veux plus. J'ai plongé tête première dans le terrier du lapin blanc. Et au comble du cliché de la femme heurtée, je cherche désormais l’artifice. Je cherche la facticité.
Et par-dessus de tout, je cherche la
douleur.
Parce que la
douleur, c’est tout ce qu’il me reste de toi.